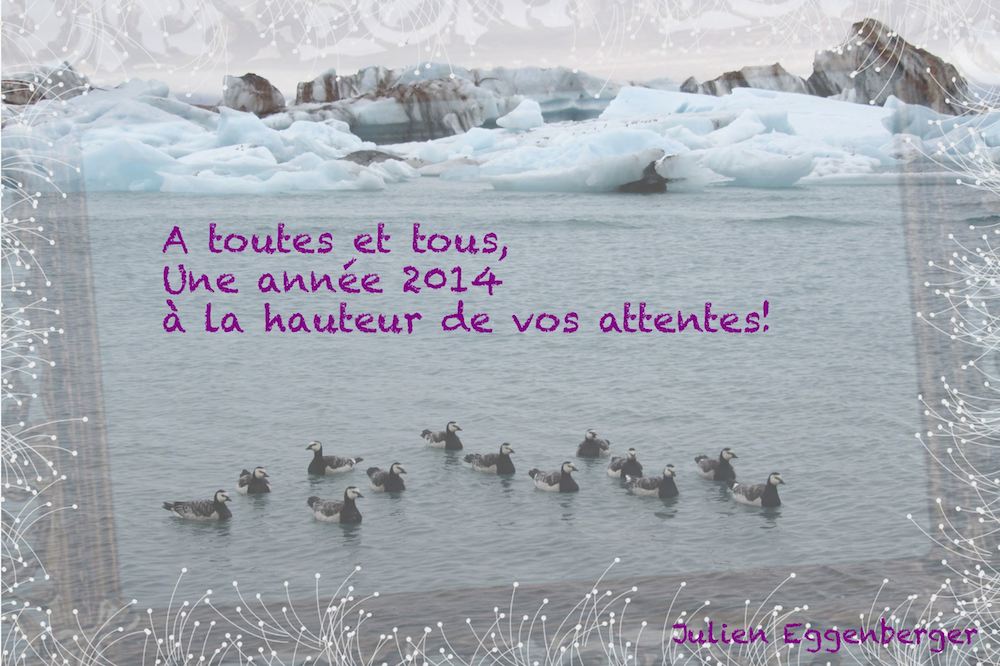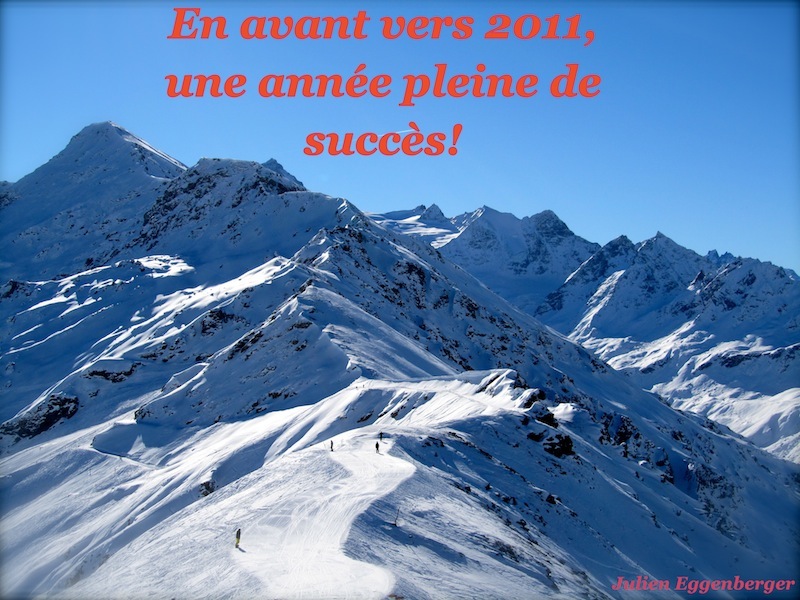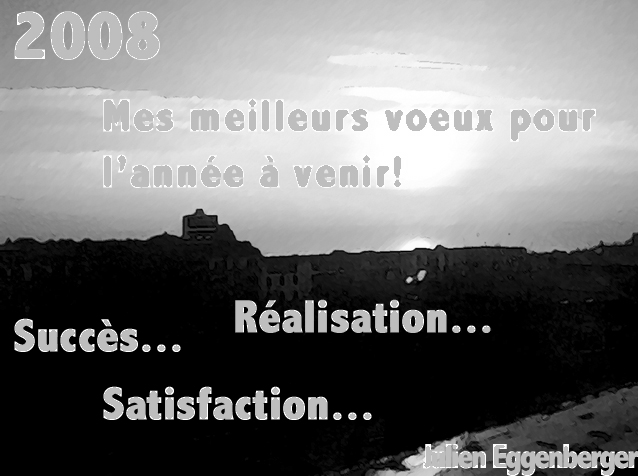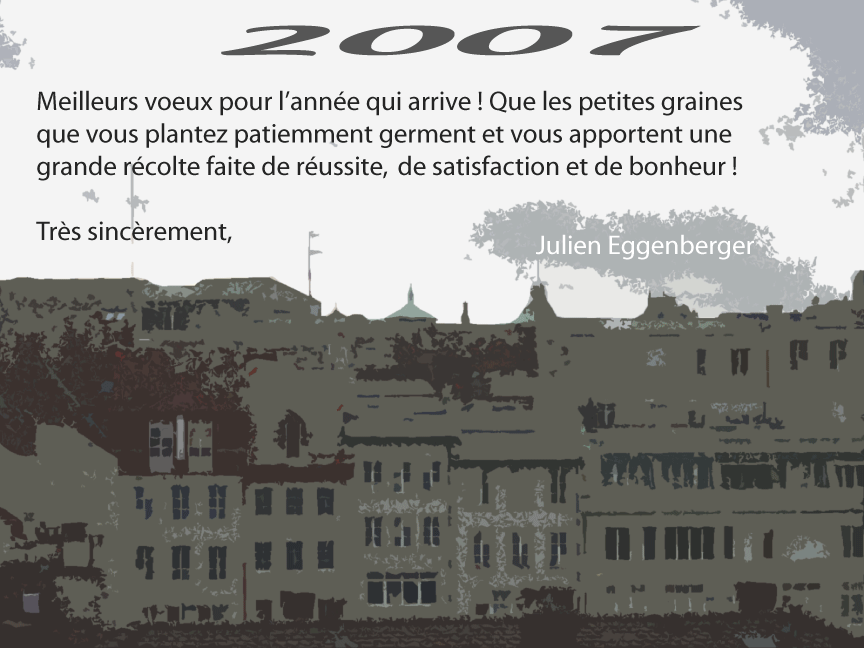![]() Article 24 Heures du 11 avril 2015 – Marie Nicollier
Article 24 Heures du 11 avril 2015 – Marie Nicollier
Education : Pénurie oblige, les étudiants en échec définitif à la Haute Ecole Pédagogique vaudoise sont employables.
«C’est extrêmement problématique», s’inquiète Julien Eggenberger, président du Syndicat vaudois des services publics.
Des aspirants professeurs qui ont raté la HEP et qui enseignent dans les classes vaudoises? C’est rare, mais cela existe. Les personnes qui se sont vu signifier un double échec, donc un définitif, par la Haute Ecole pédagogique peuvent en effet être engagées pour des remplacements. «Nous privilégions évidemment les personnes au bénéfice d’un titre d’enseignant. Mais, s’il manque des enseignants qualifiés sur le marché, on peut en effet engager ces personnes à titre d’auxiliaires», confirme Michael Fiaux, porte-parole de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO).
«C’est extrêmement problématique, juge Julien Eggenberger, enseignant et président du Syndicat vaudois des services publics (SSP), qui ignorait ce point du règlement. Je vois mal comment on peut engager en tant qu’auxiliaire des gens qui ont échoué deux fois aux examens. Aucun hôpital n’accepterait d’engager un médecin qui a échoué deux fois à ses examens de médecine. De deux choses l’une: soit l’Etat pense qu’il faut des qualifications pour enseigner, soit que n’importe qui peut le faire.»
Echecs très rares
Le directeur de la formation à la HEP, Cyril Petitpierre, rappelle le taux d’échec définitif très faible de l’institution: une cinquantaine de cas par an sur 1700 étudiants en formation de base préparant un bachelor, un master ou un diplôme. «Ces gens sont donc écartés pour de bonnes raisons; ils ont des lacunes. S’il s’agissait de mes enfants, il est vrai que je ne serais pas particulièrement heureux que leur professeur soit dans cette situation.»
Nécessité fait loi. Confrontés à la pénurie d’enseignants, les directeurs d’établissements n’arrivent parfois pas à trouver un professeur diplômé pour un remplacement dans certaines branches. «Cela n’enlève rien à la valeur du diplôme, estime Gregory Durant, président de la Société pédagogique vaudoise. On engage ces gens parce qu’il n’y a personne d’autre.»
Cyril Petitpierre reconnaît que la situation n’est pas idéale: «La seule façon de résoudre ce problème est d’accueillir plus d’étudiants pour augmenter le nombre de personnes diplômées. Même si la HEP a doublé ses effectifs depuis 2008, nous ne diplômons pas assez pour répondre aux besoins: environ 500 diplômes délivrés par an, alors qu’il en faudrait 650. C’est pour cela que nous souhaitons diversifier les voies de formation et que nous avons ouvert la Validation des acquis de l’expérience.»
Pour faciliter l’accès au titre, la HEP vient d’assouplir ses conditions d’entrée en permettant, sur dossier, de faire valider les compétences acquises dans son parcours professionnel. Trente-six personnes se sont inscrites. Le nouveau règlement donne aussi la possibilité aux personnes au bénéfice d’un CFC d’obtenir une équivalence à la maturité, et donc de suivre la formation de maître primaire.
Michael Fiaux insiste sur la diversité des profils, précisant que, «comme pour les auxiliaires ( ndlr: plusieurs centaines de professeurs sans titres pédagogiques), ce sont leur expérience professionnelle et leurs connaissances dans une branche qui seront déterminantes». Gregory Durand acquiesce: «Je préfère que les élèves soient encadrés par quelqu’un qui a fait tout son cursus à la HEP et raté un examen à la fin qu’un étudiant en première année de Lettres à l’UNIL qui ne connaît rien à l’école. Si c’est un problème de nature pédagogique qui a mené à l’échec, on peut en effet être surpris d’un engagement. Il faut aussi considérer le type de remplacement: si c’est un congé maternité, cela devient plus ennuyeux que si c’est un remplacement d’une journée.»
Combien sont-ils à enseigner après un échec définitif aux examens? «Très très peu», estime Gregory Durand. «J’ai eu vent de moins de dix cas», réagit Cyril Petitpierre. La HEP et la DGEO disent n’avoir aucune statistique; il s’agirait majoritairement de temps partiels.
Si ces aspirants profs constituent une soupape de sécurité bienvenue en temps de disette, il n’est pas question de leur ouvrir les portes d’une carrière dans l’enseignement vaudois. Ils sont au bénéfice d’un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable au maximum deux fois.